
© E.D. Distrbution
PUTTY HILL
un film de Matt Porterfield
avec : Sky Ferreira, Zoé Vance, James Siebor Jr., Dustin et Cody Ray…
Putty Hill est un quartier de Baltimore, profondément remué par l’overdose mortelle de l’un de ses jeunes habitants. Les proches de l’adolescent, amis et parents, abaissent les masques et expriment leur mal-être devant la caméra de Porterfield, lui aussi enfant du quartier…
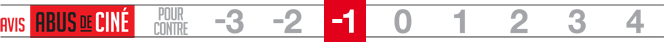

L’insoutenable légèreté du mal-être
Dans « Putty Hill », Matt Porterfield pousse l’indistinction entre réalité et fiction jusqu’à interroger lui-même, en voix off, les « acteurs » du drame qui s’est joué dans ce quartier défavorisé de Baltimore. Alors qu’il filme un adolescent assis sur le bord d’une rampe de skateboard, la voix du cinéaste surgit dans le champ, une voix à la fois paternaliste et inquiète, rassurante et inopportune. Le garçon répond laconiquement. La caméra se fait intruse : elle tente de capter l’émotion, quand la jeunesse n’oppose qu’un visage inexpressif. Il attrape bientôt son skate et quitte le champ ; Porterfield le suit, de plus loin ; dans un plan d’ensemble qui voit le jeune homme s’éloigner aux côtés d’un camarade, et tandis qu’ils s’abîment dans la perspective, leur dialogue s’entend toujours aussi nettement sur la bande son : le procédé cinématographique se révèle implicitement via cette prouesse technique, car il faut bien, soit que les deux skateurs portent un micro, soit que leur conversation soit postsynchronisée. Contrairement aux apparences, « Putty Hill » est donc bien, avant tout, un film de cinéma. Mais un film qui plonge ses racines dans le naturalisme le plus cru…
Et malheureusement, aussi, le plus ennuyeux. Car, si toutes les trajectoires du projet esthétique, narratif et émotionnel de Porterfield sont aisément visibles, c’est le projet d’ensemble qui manque cruellement de vitalité et de cœur. L’idée (filmer les conséquences sentimentales de la mort d’un garçon du quartier par overdose) est belle. Le principe de faire appel à des comédiens non-professionnels : d’accord. L’aspect autobiographique (Porterfield a grandi dans un quartier de Baltimore qui sert de modèle à celui-ci, où il a déjà tourné son premier long-métrage, « Hamilton »), ça fonctionne bien. Seulement, la mise en scène, sous couvert de naturalisme, est d’une platitude épuisante ; le travail du cadre se limite à circonscrire les visages et les corps sans quitter le domaine du documentaire télévisé, et dès lors qu’une scène se veut plus émouvante, le réalisateur se contente de laisser défiler sa pellicule sans intervenir. Symptomatique est cette longue, longue, longue scène qui voit Jenny pleurer sur le balcon de la maison de son père tatoueur, et s’en prendre violemment à lui dès qu’il tente de communiquer avec elle. On se surprend alors à espérer un événement, n’importe lequel. Qu’un truc tombe du ciel, ou qu’un éclair pulvérise une antenne TV. Bref, qu’il se passe quelque chose.
Cela dit, « Putty Hill » est une œuvre si profondément affective que cet avis critique est limité à la capacité émotionnelle de son auteur. D’autres seront sans doute touchés par le tact précis et l’humilité visuelle de Porterfield, qui se fait l’acteur plus que le témoin de la tristesse des habitants du quartier, du mal-être de toute une population défavorisée. D’autres seront émus par la retenue de ces « personnages », archétypes d’une génération sacrifiée. D’autres encore seront bouleversés par la scène finale du karaoké, parfaitement insolite, qui voit les participants à l’enterrement pousser la chansonnette et remuer du popotin comme pour contrer la fatalité. Mais il y a aussi le spectateur pour qui l’insoutenable douleur humaine se change aisément en insupportable complainte sociale ; le spectateur que ce type de non-spectacle, idéalement destiné à illustrer un reportage de journal télévisé, agace profondément, lorsque l’épuration visuelle semble se confondre avec l’absence de style.
LA BANDE ANNONCE
Cinémas lyonnais
Cinémas du Rhône
Festivals lyonnais










