
© Mars Films
DÉSOBÉISSANCE
(Disobedience)
un film de Sebastian Lelio
avec : Rachel Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivola, Anton Lesser, Allan Corduner, Nicholas Woodeson...
Ronit, fille d’un père orateur d’une synagogue, retourne chez elle à la mort de ce dernier. Une réapparition qui provoque quelques tensions au sein de cette communauté juive très fermée sur elle-même et sur ses dogmes, et qui va prendre un autre relief lorsque son amie Esti, désormais mariée à un orthodoxe convaincu, lui avoue ses sentiments…
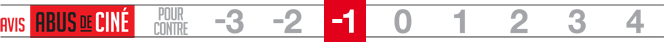

Désespérance
Il y a quelque chose de profondément exaspérant qui se repère à chaque fois dans la longue liste des films prétendument engagés contre l’étouffement communautaire : jouer la révolte par une mise en scène qui en est l’exact opposé. Dans le cas de "Désobéissance", à la fois premier film américain d’un Sebastian Lelio tout juste oscarisé et adaptation littéraire produite par l’actrice Rachel Weisz, on a la totale. La liste des thèmes à aborder a beau s’avérer longue comme le bras (ostracisme, poids du dogme, liberté contrariée par une religion persécutrice, aliénation par le patriarcat, irruption du saphisme comme élément subversif, etc…), la liste des choix cinématographiques qui les trahissent un par un l’est tout autant. Rarement avait-on eu l’occasion d’assister à un film qui prône à ce point la liberté et l’émancipation au travers d’une mise en scène qui en est l’exact opposé. Image glaciale, esthétique grisâtre et dépressive, intérieurs blancs comme des cachets d’aspirine, symbolisme au point mort, grammaire verbale plus basique tu meurs : tout suinte un vieux emballage académique et plus chaste que jamais, où rien ne dépasse, où rien ne s’écarte des codes (y compris quand il s’agit d’aller à l’encontre de ceux-là), donc aux antipodes d’une prétendue désobéissance aux conventions.
À la réflexion, une telle glaciation visuelle aurait pu sembler justifiée avec un cinéaste comme Atom Egoyan aux commandes – sa patte théorique et ses savantes constructions narratives ont su révéler leur intérêt pour incarner intelligemment une forme de subversion. Sauf que Lelio, échappé d’une poignée de mélodrames pseudo-almodovariens ("Gloria", "Une femme fantastique"), n’est pas Egoyan. Sans aller jusqu’à qualifier le film d’hypocrite, on n’hésitera cependant pas à y déceler un profond schématisme dans l’illustration de ses thèmes, tant le film ne compte que sur ses dialogues (poussifs) et son casting (inexpressif) pour travailler sa matière. Entre deux actrices robotisées dont l’alchimie ne se révèle être qu’une vue de l’esprit (on ne sent aucune fièvre amoureuse chez l’une ni chez l’autre), une scène de sexe saphique supra-grotesque (l’idée du crachat dans la bouche, ça sert à quoi ?) et un éloge final de la liberté énoncé de façon répétée et à haute voix (au cas où on n’aurait pas déjà pigé ?), on déguste ici un cinéma hollywoodien basique, sans vie ni énergie interne, branché sur respirateur artificiel afin de faire passer son propos par autre chose que le découpage et la scénographie. Sortir de ces deux heures étouffantes a au moins le bon goût de nous rendre plus libres qu’on ne l’était en les regardant, et c’est bien là la seule qualité que l’on mettra à leur crédit.
LA BANDE ANNONCE
Cinémas lyonnais
Cinémas du Rhône
Festivals lyonnais










