DOSSIER
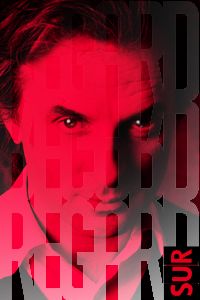
REGARD CINEMA SUR... Christophe Grangé
La sortie de « La Marque des anges », adaptation du roman Miserere, pousse forcément à s’interroger : pour quelle raison d’aussi bons romans que ceux de Jean-Christophe Grangé se traduisent-ils par d’aussi piètres portages cinématographiques ?
C’est peut-être qu’il existe une loi du genre, formalisée par Stanley Kubrick et Alfred Hitchcock : il n’y a que les mauvais livres qui fassent de bons films, les ouvrages de qualité étant inadaptables.
Cet adage ne plaira sans doute pas aux groupies des Harry Potter et autres Twilight, attachés au filmé comme à l’écrit lorsqu’il s’agit de leurs héros favoris, mais régulièrement, les ratages inspirés de notre best selling Grangé tendent à prouver qu’en la matière, et dans tous les cas ou presque, il faut savoir écouter les maîtres d’antan.
Des idées bien Grangé
Il faut imaginer ce grand type aux cheveux longs, sorte de BHL en moins bobo et sans chemise à col ouvert, traîner ses guêtres dans les pays les plus reculés pour quelques photos envoyées à Paris Match ou au National Geographic. Le talent d’écrivain de Grangé n’a d’égal que son insatiable curiosité. De Boulogne-Billancourt, où il est né, au site d’Angkor Vat au Cambodge dont il assiste à la restauration, il y a un grand pas que ce journaliste dans l’âme franchit en passant des contrats pour les magazines à la création de sa propre société, L&G. Lauréat du prix Reuter pour un reportage sur la déforestation (« Péril en la forêt ») et du prix World Press pour le dressage des oiseaux en vue de la pêche en Chine (« La ballade des cormorans »), Grangé abandonne sa carrière pour se lancer dans l’écriture de romans, continuation logique de son goût pour les voyages et les découvertes culturelles. Le Vol des cigognes, paru en 1994, s’inspire d’une année consacrée à la rencontre des peuples nomades à travers le monde en compagnie d’un anthropologue. C’est le point de départ d’une fulgurante carrière d’auteur dont les tentacules sauront s’affranchir des frontières de l’Hexagone pour s’en aller explorer l’étranger – chose assez rare pour un romancier français.
Les Rivières pourpres, L’Empire des loups, Miserere, ou plus récemment Kaïken… Les thrillers de Grangé fonctionnent sur une idée a priori toute simple : l’efficacité de la construction narrative. Peu d’écrivains du genre travaillent autant la structure de leur récit en la complexifiant un maximum, sans jamais la rendre incompréhensible ou trop tirée par les cheveux. Même s’il s’autorise régulièrement à frôler de près la ligne qui sépare le réel du fantastique, jusqu’à l’outrepasser à de rares occasions (Le Concile de pierre). L’aisance visible de la forme, souvent basée sur l’équation assassinat + enquête, se démultiplie sur le long terme, en proposant typiquement un dédoublement de l’investigation (deux personnages travaillent sur deux affaires différentes, qui n’en feront bientôt plus qu’une) ou un renversement des points de vue (dans L’Empire des loups, les cartes sont rebattues pour l’héroïne lorsque sa propre personnalité est remise en cause). Le but consiste presque toujours à relater la progression initiatique d’un ou plusieurs protagoniste(s) via le surgissement d’une révélation ou d’un secret qui le(s) fait(font) voyager au plus près de l’impossible.
Voilà, semble-t-il, du pain béni pour le cinéma. Et pourtant, on le verra, l’adaptation cinématographique de son œuvre, rendue évidente par la proximité de ses romans avec la forme scénaristique, n’a pas abouti à des chefs-d’œuvre. Ce serait même plutôt l’inverse. À l’instar d’un Dan Brown, dont les livres semblent converser directement avec le 7e Art, et qui s’est vu massacrer (encore plus que de raison), à deux reprises, par Ron Howard, notre Grangé national n’a pas eu la chance de se voir correctement porté sur grand écran. Interrogé sur ces adaptations et leur inexplicable manque de réussite, l’intéressé répond avec franchise en citant Hitchcock : « Le problème de base vient de mes livres dotés d’une cohérence tout au long des 500 pages, où chaque détail compte. Exprimer tout ça en 1h30, ce n’est pas mission impossible mais quelque chose de pas facile à faire. La meilleure méthode est peut-être celle d’Alfred Hitchcock qui disait : je lis un livre, je l’oublie, je ne retiens que l’histoire et je la raconte à nouveau avec les moyens du cinéma. »
Lui-même scénariste à ses heures (pour « Vidocq » de Pitof en 2001, certes pas l’une des meilleures choses que l’on ait vues au cinéma ; « Switch » coécrit avec Frédéric Schoendoerffer, en 2010), Grangé a participé à l’écriture de deux des adaptations de ses romans, pour « Les Rivières pourpres » et « Le Vol des cigognes ». N’est-ce pas en soi une contradiction, pour quelqu’un qui encourage à négliger le livre pour en tirer la substantifique moelle afin de repartir à zéro ?
Les Rivières sauvages
Le second roman de Grangé, sorti en 1998 chez Albin Michel, le confirme en tant qu’écrivain. Mais c’est son adaptation deux ans plus tard par Mathieu Kassovitz, révélé par « Métisse » et « La Haine », qui le propulse au firmament des stars du papier. Avec plus de trois millions d’entrées, le film est un gros succès qui légitime pleinement un Kassovitz en état de grâce, avant sa déclinaison progressive du côté d’Hollywood, et encourage parallèlement Grangé à poursuivre dans la voie bienvenue du thriller sanglant.

Les Rivières pourpres, le livre, fonctionne sur le modèle très cinématographique du montage alterné, pendant une bonne centaine de pages, entre les enquêtes a priori indépendantes du commissaire Pierre Niémans, à Guernon, sur les lieux d’une mutilation, et du jeune inspecteur Karim Abdouf, à Sarzac, suite à la profanation d’une tombe enfantine. Les deux personnages ainsi que leurs histoires croisées sont conservés dans le film, à ceci près que Karim Abdouf devient Max Kerkerian pour mieux correspondre à son interprète, Vincent Cassel, tandis que Jean Reno endosse le costume tout désigné du commissaire ex-star de l’antigang (le roman débute d’ailleurs sur une émeute post-match du PSG aux alentours du Parc des Princes). Dans un second temps, les enquêtes se rejoignent et les protagonistes unissent leurs forces, plus ou moins aidés par Fanny (Nadia Farès à l’écran), et le récit devient une succession de découvertes de cadavres mutilés et de scènes explicatives qui, elles, disparaissent purement et simplement devant la caméra.
Grangé et Kassovitz travaillent de concert sur le script. Le réalisateur partage l’idée du romancier qui considère volontiers qu’« une fiction d’une heure trente doit être efficace, explicite, dynamique », ce qui a pour effet de restructurer le récit autour d’une narration simplifiée à l’extrême : présentation des deux policiers, rencontre, enquête commune, scènes d’action et de poursuite, dénouement. Pour un roman qui repose également sur la manipulation des faits et des gens, on peut regretter que l’aspect psychologique voulu par Grangé soit sacrifié sur l’autel de l’efficacité, et notamment le jeu de l’anagramme sur le nom de l’enfant – un climax romanesque absolu. Absorbé par un « système » qui pousse à écrire droit au but pour gagner en spectateurs ce qu’on perd en complexité, Grangé pousse Kassovitz du coude : « Donne des coups de pied dans le bouquin, on s’en fout, changeons les trucs, changeons ce qu’il faut pour que le film soit le film ». Résultat, le film est réussi à court terme, parce qu’il a su s’affranchir d’une production hexagonale très consensuelle ; mais, à long terme, « Les Rivières pourpres » ont totalement disparu de notre mémoire, le prix à payer quand on souhaite frapper un grand coup plutôt que de construire une œuvre en finesse.
Une suite, imaginée par le généreux Luc Besson, sort en 2004 sous le titre « Les Rivières pourpres 2 : L’Ange des ténèbres », avec toujours Jean Reno, cette fois accompagné de Benoît Magimel et, aussi étrange que cela puisse paraître, sauf si l’on se figure un chèque avec beaucoup de zéros derrière le « un », secondé par la présence de Christopher Lee dans un petit rôle. Olivier Dahan réalise mais ne se rend pas compte qu’il autodétruit une carrière mort-née aussi certainement qu’on se suicide en se transperçant avec une tronçonneuse allumée.
Le pire des loups
Sorti trois ans après Le Concile de pierre, L’Empire des loups, paru en 2003, trouve plus rapidement le chemin des studios. Attention : ce roman est une claque, puissante et précise, assénée au lecteur en plein visage. Le film qui en est tiré par Chris Nahon, cinéaste issu de l’écurie EuropaCorp (« Le Baiser mortel du dragon » en 2001), sans être la plus odorantes des bouses qu’on a jusqu’à ce jour lancées sur l’écran d’un cinéma, n’en arrive évidemment pas à la cheville – mais, du moins, sa première partie vaut le coup d’œil, pour peu qu’un ami ingrat ne vous ait pas révélé le « truc ».

Ouvrir les pages de ce livre, c’est plonger volontairement dans les profondeurs du cerveau et de la personnalité. Anna Heymes, son héroïne, est progressivement amenée à douter de son environnement immédiat suite à des crises hallucinatoires et à des amnésies partielles qui ont pour conséquence de lui rendre étranger le visage de son propre mari – autant d’idées que Grangé a puisé lors d’un reportage sur la cartographie du cortex, « Voyage au centre du cerveau ». En parallèle des angoisses d’Anna, le policier parisien Paul Nerteaux prend les conseils d’un ancien collègue, Jean-Louis Schiffer, afin de résoudre le mystère de la mort de trois immigrantes turques assassinées dans des ateliers clandestins de confection, sans doute par une mafia délocalisée (affaire également inspirée d’une enquête journalistique, « Les enfants de la mafia », menée en Sicile). Jean Reno rempile dans le costume du vieux flic farouche tandis que le jeune loup est incarné par Jocelyn Quivrin (acteur prometteur malheureusement décédé dans un accident de la route en 2009), remplaçant au pied levé Olivier Martinez. La bonne idée du casting, c’est la présence d’Arly Jover en Anna, délicieuse espagnole au regard inquiet et aux yeux tristes qui parvient parfaitement à traduire la fébrilité de son personnage.
Le contrat liant Grangé à Gaumont stipulait que le film devait se faire dans les plus brefs délais ; un an environ après la sortie du livre, le tournage débute à Paris. Trop rapide pour être honnête ? Grangé produit un traitement séquentiel comme base du futur scénario, avant d’en rédiger une première version sous la pression du studio. Il quitte ensuite le navire et laisse le bébé à Chris Nahon, sans doute avec le rictus de celui qui sait quelle bombe il vient de lâcher. « L’Empire des loups » sort en avril 2005 et engrange quelques 750 000 entrées – un four pour une production de cet acabit. La raison ? Des personnages trop caricaturaux (stop, Jean Reno, stop !), des scènes d’action grotesques et un récit mal équilibré. Si la première demi-heure parvient, tant bien que mal, à tenir la dragée haute au roman, c’est grâce à Arly Jover et au questionnement de son personnage sur son propre cerveau, une problématique plutôt bien rendu à l’écran. Mais le pire, c’est le dénouement : autant le roman se conclue de manière tragique, finalité logique à un récit parmi les plus sinistres de l’écrivain, autant le film joue la carte de l’improbable happy end, au mépris de la direction pourtant prise par l’histoire. Du grand n’importe quoi filmé sous le soleil de la Turquie où l’équipe semble avoir bien profité de ses vacances.
Un hibou pas chouette
L’adaptation du Concile de pierre, troisième roman de Grangé, sorti en 2000, a demandé plus de temps que celle de L’Empire des loups… pour un résultat pire encore. Guillaume Nicloux adapte librement le roman, ce qui n’est pas pour déplaire à son auteur, qui lui conseille de ne lire que « dix lignes » de son livre, « puis [de] le repenser pour en faire un film ». En somme, Grangé lui a refilé une patate chaude que Nicloux a consciencieusement transformée en gros navet.
Il faut avouer qu’en tant que tel, Le Concile de pierre n’est pas un cadeau pour un scénariste. Là où les autres romans de Grangé ne franchissent jamais la ligne du fantastique, celui-ci ne s’encombre pas de détails et fonce dans le tas, quitte à perdre de sa force lorsque, sur la fin, le délire devient total. Reste que l’essentiel du roman est époustouflant. Son héroïne, Diane, poursuivie par un traumatisme rituel ancien, interdite physiquement d’avoir des enfants, adopte un thaïlandais de six ans qu’elle prénomme Lucien. Le terrible accident de la route qui suit manque de briser la famille naissante, en plongeant Lucien dans un profond coma et en grignotant les certitudes de cette jeune femme rationnelle et cartésienne à souhait. La voilà partie en road trip en Asie pour enquêter sur les mystérieuses origines de son fils adoptif, jusqu’à un passage en Mongolie qui n’est pas piqué des hannetons. Le pragmatique y perd un peu de son latin, mais la balade puise ses fondations dans une audace brillante et envoûtante – à tel point que le livre fera des émules avec une bande-dessinée de Philippe Adamov, La Malédiction de Zener, un prologue au Concile de pierre à travers la jeunesse d’un personnage emblématique.

Ce n’était pas idiot de confier le rôle de Diane (renommée Laura pour l’occasion), femme forte de corps et fragile d’esprit, à Monica Bellucci. Catherine Deneuve joue sa mère, Sybille, et le casting emmène aussi Elsa Zylberstein ainsi que Sami Bouajila. Malin comme tout, Grangé ne s’approche du scénario ni de près, ni de loin. Seulement, voilà, tout ce que Nicloux essaie de faire à l’écran se brise les pattes. Le problème ne vient pas uniquement d’un scénario mal ficelé, et qui opère des choix discutables – pourquoi réveiller Lucien de son coma pour le faire kidnapper immédiatement par des vilains, métamorphosant le voyage de l’héroïne en poursuite désespérée quand, chez Grangé, il s’agissait d’un parcours initiatique remontant vers ses propres origines ? Il y a aussi, visible et insistant, un manque flagrant de volonté de produire quelque chose de crédible, comme si l’on avait voulu occulter de force tout ce qui, dans le roman, est créateur d’émotions et d’ambiguïté.
Par exemple : l’accident. À l’écrit, cette scène impressionne : Diane, au volant de sa voiture sur le périphérique, manque de se faire écraser par un camion brusquement dévié de sa course pour aller s’encastrer contre la glissière de sécurité opposée, emportant l’héroïne dans son sillage. Toute la question consistera ensuite à comprendre comment un tel accident a pu avoir lieu, d’autant plus que le chauffeur du camion ne se souvient de rien. Mais, dans « Le Concile de pierre », le tragique accident de camion est remplacé par… un hibou qui s’écrase sur le pare-brise de Monica Bellucci ! Un hibou contre un poids lourd ? Même si tous les psychiatres de France se penchaient sur la question durant une bonne année, il est douteux qu’ils parviennent à comprendre pourquoi Nicloux a préféré la vulgaire et banale attaque de chouette à la remarquable collision sur le périphérique parisien.
La valse des gigognes
En janvier 2013, Canal + a diffusé un téléfilm en deux épisodes adaptant le premier roman de Grangé, Le Vol des cigognes, presque vingt ans après sa parution. Développé par l’auteur en personne, le film a bénéficié d’une coproduction de Canal + avec EuropaCorp TV (donc gros moyens) et de la réalisation de Jan Kounen, le papa de « Doberman » et de « Blueberry ». Résultat ? Pire que tout, si c’était possible.
Étonnant dans sa forme comme dans son déroulement narratif, Le Vol des cigognes est souvent considéré comme l’un des meilleurs romans de Grangé, malgré ses scories en guise d’erreurs de jeunesse. Puisant son inspiration dans son reportage sur la migration des cigognes, « Voyages d’automne », Grangé construit page après page une fascinante affaire d’oiseaux disparus mêlée à la découverte, par son héros, du secret enfoui de sa famille. Louis laisse derrière lui son mentor, l’ornithologue Max, victime d’une crise cardiaque en Suisse, pour suivre la piste des cigognes entre l’Europe et l’Afrique, en passant par les kibboutzim d’Israël. Descriptions de paysages alternent avec poursuites effrénées, le tout renforcé par un puissant mastic fait de suspense. Le film de Kounen met tout à plat et distille, en trois heures, une intrigue incompréhensible, réduite à ses plus simples expressions (un indice essentiel lancé comme une fleur ici ou là), pour préférer au complexe récit de Grangé le parcours d’un junkie, devenu Jonathan plutôt que Louis, qui consomme allègrement des substances illicites entre deux parties de jambes en l’air avec la jolie Israélienne croisée au milieu de nulle part.

Hormis Jan Kounen qui semble avoir un réel problème avec les drogues, étant donné qu’elles forment la substance de tous ses films, et sa mise en scène limitée à des gros plans fixes de visages filmés en champ-contrechamp, « Le Vol des cigognes » traîne encore d’autres boulets plus handicapants. Rythme mollasson, acteurs insupportables, réactions improbables… Les deux épisodes forment une succession de séquences bâtardes, arbitrairement validées par un Grangé en apnée, qui atteignent au pur délire lorsqu’un insolite rabbin à mitrailleuse débarque pour dégommer Jonathan dans un kibboutz que même les scénaristes avaient oublié. Le tout précédé par une scène d’ouverture, en guise de générique, qui dure la bagatelle de huit minutes ! Encore raté, comme dirait l’autre…
En somme, le bilan n’est pas fameux et l’adage kubricko-hitchcockien se vérifie dans tous les cas pour Grangé – en attendant l’adaptation, par Sylvain White, de Miserere, pour lequel les espoirs sont peu permis. On entend dire que les droits du Serment des limbes ont été achetés et que l’auteur pourrait lui-même rédiger le scénario de Kaïken dans les mois à venir. La forêt des mânes est surtout une manne financière pour l’écrivain, que la destruction en règle de chacun de ses romans ne semble pas inquiéter plus que de raison ; peut-être, in fine, pour que les spectateurs reviennent toujours vers ses livres ?
Eric Nuevo
Cinémas lyonnais
Cinémas du Rhône
Festivals lyonnais










