DOSSIER
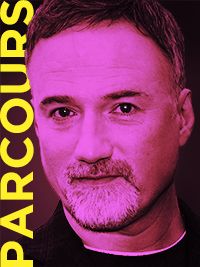
PARCOURS : David Fincher, jamais là où on l’attend
David Fincher, reconnu aujourd’hui comme l’un des plus grands créateurs de notre époque, a un parcours assez particulier. S’il est connu pour avoir réalisé de très grands thrillers, ses capacités ne se limitent pas à ce genre. Tel un caméléon, il s’est en effet essayé à différents genres avec brio. Sa carrière n’est pas si facile à analyser. Il n’y a pas deux grands courants, comme le pensent une partie des analystes, mais une suite de films avec des points communs un peu plus subtiles qu’on ne l’imagine. Il a attendu longtemps avant d’avoir une reconnaissance quasi unanime, et il est connu pour avoir une très forte personnalité, notamment dans ses négociations avec les studios. Analyse.
Sa carrière commence mal. La production d’"Alien 3" (1992) est très douloureuse. Il reçoit le scénario au compte-gouttes et est viré de la salle de montage. Malgré ces déboires, il livre le film le plus glaçant de la série, se permettant le luxe de tuer l’héroïne. De plus, il impose sur grand écran, dans la lignée de ses clips et pubs, un style visuel et sonore sophistiqué et esthétisant (ce qui lui sera souvent reproché). Fincher donne instantanément la couleur : il a un œil et une grande gueule (une des raisons de son éviction de la salle de montage).
L’ambiance de “Seven” (1995) est certainement encore plus sinistre. Mais Fincher continue, réunissant la forme et le fond dans un alliage unique. Il n’écrit pas, mais se bat pour tourner la première version du script, la plus noire. Lors d’une projection test, une femme dit vouloir tuer le réalisateur de cette atrocité ! Le générique de fin va à contre sens. La musique est grinçante. Le « serial killer » est éliminé, mais contre toute attente, il a pourtant gagné. Le public, qui n’est pas brossé dans le sens du poil, tombe des nues et aime ça.
“The Game” (1997) raconte les mésaventures d’un homme richissime devenu trop imbu de lui-même selon son frère. Les murs ne suintent plus mais Fincher n’en est pas moins assez cynique dans le traitement qu’il offre à ce personnage, qu’il enterre littéralement à mille lieues de chez lui. Il lui en fait baver, de manière un peu moins sadique qu’on ne pourrait le penser, mais le personnage de Van Orthon ne passe pas un bon moment. La photographie est à son image, classe et propre, plus conventionnelle que pour “Seven”, ainsi que le découpage qui est plus discret, mais très carré, avec des cadrages millimétrés. Par contre, Fincher offre un surprenant happy end, pouvant donner l’impression qu’il s’est un peu adouci. Un peu d’humanité dans ce monde de brutes ?

On constate qu’il n’en est franchement rien avec “Fight Club” (1999), un des ses projets les plus ambitieux et personnels, à la gestation compliquée et difficile (Fincher réduira son salaire pour que le film se fasse). À sa sortie, le film reçoit un accueil catastrophique. Trop violent, trop excessif, trop nihiliste. Fincher porterait avec lui des relents du nazisme (les hommes au crâne rasé, qui fabriquent du savon provenant de la graisse des femmes riches) et serait également pro-gay (les deux hommes vivent ensemble). La presse le lapide, affirmant que la mise en scène est tape-à-l’œil et que le cinéaste est inconscient de la violence qu’il a filmée. Il est vrai que les amateurs de Tarkovski risquent ici l’infarctus, un peu comme quand on attend 70 ans pour monter à cheval et partir au galop. Fincher, qui espérait que le film serait décortiqué et accompagné par des analystes, en est pour ses frais. Les jeunes voient cependant le film qui, grâce à eux, devient culte.
David Fincher, ce prophète
Oui, “Fight Club“ est violent. Sa violence physique très crue et hyper réaliste choque un public habitué aux « gunfights » usuels des films ordinaires. Les gens détestent ce soudain accès de révolte contre la société qu’ils ne comprennent pas. Fincher propose l’idée que des gens retrouvent l’impression d’être en vie en se battant, puis qu’ils passent à la vitesse supérieure en saccageant la société qui asservit tout le monde. D’où, en partie, un réel esthétisme dans les combats, également très gores, dans lesquels les combattants prennent bien paradoxalement du plaisir.
L’histoire parle surtout de schizophrénie, ce que la réalisation supporte magnifiquement, en étant d’une maîtrise technique rare, et en jouant à bon escient sur la notion de point de vue. Le cinéaste soigne tout autant ses acteurs qui font un nombre de prises hallucinant sur tous ses films. Avec “Fight Club“, le cinéaste offre l’un des films de la décennie. Il propose, tel un prophète, deux ans avant le 11 septembre 2001, en image de fin, deux buildings qui explosent, résumant ainsi le ras-le bol de groupes extrémistes qui ne partagent plus les valeurs de l’« American way of life ». Fincher ne prône en aucun cas le bienfait des actions de ce groupe, mais montre au contraire que leur ras-le-bol les a emmené beaucoup trop loin, dirigés par un leader devenu gourou (le narrateur se bat à la fin du film pour tout stopper).
Après cette fable rebelle, Fincher fait ensuite plus léger et livre “Panic Room” (2002), son film mineur, une série B de luxe, l’équivalent d’une fusée dans une cour de récréation. Après un tournage long et compliqué, le film est apprécié mais secoue moins, si bien que certains se demandent où est passé Fincher. Certains l’ont accusé d’être inconscient et naïf sur “Fight Club”, et paradoxalement ceux-là même trouvent “Panic Room” trop gentil. En France, le film sort alors que Le Pen arrive au second tour de la présidentielle. Les français se rendent alors plus dans la rue qu’au cinéma.

Après un traitement avorté de “Mission Impossible 3” (Fincher comme Cruise étaient intransigeants), il vogue vers “Zodiac” (2007), l’histoire d’un tueur en série qui a effrayé Fincher en perpétrant des crimes à l’époque où il était gosse. On parle de documentaire, et il s’agit pour tous du « film de la maturité ». Fincher est égal à lui-même, soigne toujours autant acteurs, sujet et mise en scène, mais il se fait simplement discret. On lui a reproché d’en faire trop, notamment lors du fameux plan séquence de “Panic Room”, qu’on a pu trouver surfait, mais qui permettait de savoir en temps réel où étaient tous les agresseurs qui menaçaient Meg Altman et sa fille. Un peu de spectaculaire dans un film tout public, rien de bien méchant. Avec “Zodiac” on est dans l’anti-spectaculaire. Fincher choisit le réalisme et quand le tueur poignarde une de ses victimes, il n’y a pas de gerbe de sang, simplement un tissu qui se rougit pendant que le personnage hurle. Le cinéaste montre trois hommes qui alternativement se cassent les dents sur l’affaire. L’un abdique, l’autre divorce, le troisième finit alcoolique, et le meurtrier n’est pas arrêté. Pourquoi dans ces conditions en rajouter ? Tout le monde attendait “Seven 2”, ce sera simplement “Zodiac”, qui décevra un peu le public, prit encore à contre-pied, et qui trouve le temps long. Il est vrai que le rythme est un peu lâche et que le film est très amer. À l’opposé, la critique jubile, adore. Fincher est enfin un cinéaste à considérer.
L’étrange histoire de Mark Zuckerberg
“L’Étrange histoire de Benjamin Button” (2008) présente les mêmes symptômes. Film basé sur le temps et l’amour, il sera lent, et Fincher filme à répétition la mort, tandis que le passage réellement heureux du film est très court, constitué de plans d’une beauté sidérante mais qui se fondent les uns dans les autres. Le projet est sincère au possible, mais Fincher est le grand perdant aux Oscars, car le projet fait « grosse machine à fric américaine » et on lui préfère le dénouement heureux de “Slumdog Millionaire”, qui fait plus vrai et donne la pêche.
Pour “The Social Network” (2010), personne ne faisait confiance à Fincher pour ce « Facebook movie », dont il gardera inéluctablement l’appellation. Fincher est carrément obligé de revenir à la charge pour convaincre Trent Reznor et Atticus Ross de s'occuper de la musique (ils remporteront finalement un Oscar), de même que le directeur photo Jeff Cronenweth qui est dubitatif quant à l’intérêt de Fincher pour ce film. Ceux qui connaissent son talent prédisent cependant « un film de bureau très bien éclairé ». Fincher, tel un caméléon, aborde encore un thème complètement différent. “Zodiac” marquait un tournant pour les mauvais analystes pour avoir été « le film de la maturité », et a donc été salué unanimement par la presse. Si l’on se réjouit de ce réveil, même tardif, on déplore les mauvais arguments. “The Social Network” marque pour le compte un vrai tournant car il est le premier Fincher à mettre tout le monde d'accord, critique dithyrambique, joli succès en salles, et récompenses, dont un Golden Globe pour Fincher et un César du meilleur film étranger. Fincher est d'ailleurs à deux doigts d'obtenir l'Oscar qui revient finalement à Tom Hooper pour le brillant “Discours d’un roi”. Les fans de la première heure ressortiront aigris de ce raté final. Peut-être l’académie souhaite-t-elle snober Fincher qu’elle sait un peu hautain, notamment pour avoir refusé de s’abaisser à participer au plus célèbre et populaire talk show d’Amérique, lui pourtant si prolixe en interviews.

L'entente avec le studio Sony pour “The Social Network” et son producteur Scott Rudin est si bonne que ce dernier propose dans la foulée à Fincher... une nouvelle adaptation de “Millénium”. Autant “The Social Network” pouvait déconcerter, autant ici c'est l'inverse, même si certains trouvent qu’il est trop tôt pour refaire le film, l’original datant de quelques années. “Millénium”, avec son héroïne punk, bisexuelle et asociale, son tueur en série, ses meurtres sordides et son enquête captivante, est typiquement le genre de film fait pour lui. Fincher ne se fait pas prier, expliquant qu'il a attendu un tel projet toute sa vie. Il a l'honnêteté de considérer qu'il faut « absolument » respecter le roman et tourner en Suède. Le cinéaste reprend l'actrice découverte en ouverture du “Social Network”, la métamorphose en punk après avoir bataillé avec les producteurs et va tourner en Suède. Le tournage se déroule bien, si ce n'est que le jeune directeur photo Suédois que Fincher avait engagé pour respecter les tonalités du pays ne semble pas être au niveau souhaité, et est rapidement remercié. Cinéaste visuel par excellence, Fincher est connu pour maîtriser le travail de tous ses collaborateurs sur un plateau, et a des exigences élevées, même s'il sait donner sa chance aux jeunes. Le compagnon de route Jeff Cronenweth (“Fight Club”, “The Social Network”), délaissé la veille pour privilégier les équipes locales de la Suède, éclairera finalement le film. Fincher n'a pas peur de la violence du bouquin, et tourne les scènes de viol frontalement, sans esquiver. Pour tout admirateur du livre, c'est la moindre des choses. Venant de lui, on n'attendait pas moins. Mais pour un metteur en scène financé par Hollywood, on salue quand même la volonté de ne pas se dérober.
Fincher, l’homme qui aimait ses acteurs
Le film est un grand Fincher. La réussite artistique est totale, Fincher proposant notamment un générique stupéfiant qui rappelle celui de “Fight Club”, mais le film déçoit commercialement, car les producteurs espéraient un carton proportionnel à l’engouement pour le livre. Un script est quand même commandé pour les suites, mais est plus ou moins rangé dans le tiroir, à cause du devis un peu lourd qu'il engendre. Fincher reste littéralement muet à cet égard lors de la promo à Paris. Les monteurs du film réussissent l'exploit historique de remporter leur deuxième Oscar consécutif après celui obtenu pour “The Social Network”, mais Fincher, lui, n'est même pas nommé. “The Artist” triomphera cette année-là.
L’attente pour les fans et Fincher lui-même est ensuite un peu longue. Fincher aimant la nouveauté, il se lance dans l’aventure Netflix, et réalise le pilote d’une série destinée non pas à la TV mais à Internet. Autre surprise et fait rarissime, Netflix fait un chèque non pas pour un pilote comme c’est l’habitude, mais pour une saison toute entière. Fincher réalise les deux premiers épisodes de ce “House of Cards” qui portera sur les machinations machiavéliques qui se trament au sein de la Maison Blanche. Il y dirige un Kevin Spacey monstreux, d’un cynisme égal à celui de Fincher, et qui s’adresse régulièrement à la caméra pour confier ses états d’âme. Fincher confirme son habitude cinématographique pour les nombreuses prises, ce qui est d’autant plus remarquable dans ce monde où les budgets sont moins importants, et où les tournages sont connus pour être express.

Porté par un script brillant et un casting impeccable, la série est une réussite, artistique d’abord, Robin Wright obtient un Golden Globe, Fincher reçoit l’Emmy Award du meilleur réalisateur, et belle ironie du sort, alors que ce « produit » est destiné à Internet (bien que tourné avec des moyens de cinéma), c’est la première oeuvre de Fincher à recevoir un prix pour sa photographie (ou lumière). Avec “Seven”, “Fight Club” et “L’Étrange histoire de Benjamin Button” on aurait pensé que la récompense pour cette partie du travail de Fincher et de ses collaborateurs viendrait plus tôt, et sur un métrage plus clinquant. La réussite est aussi commerciale pour Netflix qui signe pour la deuxième saison. Pour l’anecdote, c’est en bonne partie grâce au succès de ce “House of Cards” porté par Fincher que Netflix s’est vu pousser des ailes et vient s’implanter en ce moment même en France… Petite déception pour les fans cependant, Fincher sera seulement producteur exécutif sur le reste de la série, estimant qu’il y a beaucoup trop de travail pour réaliser aussi les autres épisodes.
En attendant "Gone Girl"
Pour passer le temps, l’homme réalise un somptueux clip pour Justin Timberlake sur la chanson “Suit and Tie”. Rien de révolutionnaire, mais des plans magnifiés par un noir et blanc tout en contrastes, avec des jeux de lumières à ravir les rétines. Fincher, technicien considéré comme en avance sur son temps, a testé une caméra monochromatique et emprunté le directeur photo de “Requiem for a Dream”. Nouvelle ironie, le clip n’obtient pas de prix pour sa photographie exceptionnelle (ce qui n’est pas le cas de celle de “House of Cards”), mais Fincher obtient tout de même le prix du meilleur réalisateur vidéo de l’année (Vidéo Music Award). Le prix n’était pas attendu, mais salue sa grande élégance.
Le retour aux projets sérieux, c’est-à-dire aux longs métrages, se fait un peu attendre. Le spectateur est toujours dans l’expectative d’une suite à “Millénium”, qui ne vient pas pour des raisons inconnues et Fincher travaille sur une adaptation de 20 000 lieues sous les mers, qui tarde aussi à se concrétiser. Un autre gros projet de science-fiction ne se fait pas : “Rendez-vous with Rama”. Hasard ou coïncidence, ces trois projets pour l’heure non aboutis sont écrits par Andrew Kevin Walker, scénariste de “Seven”.
Puis début 2013, une rumeur court : “Gone girl”, un fantastique polar, très noir, est en tête des ventes, et il se murmure que Fincher serait parfait pour son adaptation. Très simplement, les droits sont achetés, Fincher est contacté, il accepte. Quelques mois après seulement, le tournage commence, comme si c’était facile. Il surprend ainsi beaucoup son monde en arrivant sur un projet qui n’était pas dans ses cartons, un « petit film » (50 millions $, quand même) qui se met en place le plus naturellement du monde. Pour le rôle féminin, compliqué, il embauche la quasi inconnue Rosamund Pike, une ancienne James Bond Girl un peu oubliée. Surprise. Pour le rôle masculin, il embauche le fade… Ben Affleck. Re-surprise. Fincher aurait-il perdu son flair ? Certes Affleck a récemment gagné une estime en tant que cinéaste, mais l’acteur n’a jamais été reconnu. À quelques jours de la sortie du film, Fincher avoue l’avoir choisit à cause de son sourire un peu niais trouvé sur Google, par lequel Affleck essaie de mettre les gens à l’aise. Cela fait écho à une scène importante du film… Pour Rosamund Pike le mystère est un peu plus entier. Après un refus d’actrices plus connues (Charlize Theron, Nathalie Portman), Fincher caste Pike car il a l’impression de ne pas la connaître.
Ignoré à Cannes, détesté à Venise, adulé à New York
Quatre ans après “The Social Network”, “Gone Girl” est sélectionné pour faire à son tour l’ouverture du festival de New York. Le festival est moins connu et réputé que Cannes, Venise, ou Berlin, mais Fincher a été ignoré à Cannes (“Zodiac”), détesté à Venise (“Fight Club”), et adoré à New York. Pourquoi donc aller ailleurs, d’autant qu’il est le seul cinéaste à avoir l’honneur de faire deux fois l’ouverture. Les premières critiques américaines arrivent un peu avant l’ouverture du festival de New York, désamorçant un peu l’effet “bombe lâchée à la dernière minute”. Elles sont pour l’instant soit bonnes, soient dithyrambiques. Pour rappel ce n’est qu’à partir de “Zodiac” que Fincher a eu une presse unanime (un soupçon mitigée pour “Millénium”), qui s’est soudainement mise à l'idolâtrer et à le mettre sur le piédestal qu’il mérite. “Première” qui a été un des seuls à reconnaître les qualités de Fincher, l’annonçait il y a peu “meilleur cinéaste actuel”.
Contrairement à “The Social Network”, Fincher, roi du thriller, est ici en territoire connu. L’histoire : Le jour de son cinquième anniversaire de mariage, Nick (Affleck) découvre que sa femme Amy (Pike) a disparu. Rapidement, tous les soupçons se portent sur lui. L’aurait-il tué? Honnêtement, ce pitch vu et revu ne fait envie à personne, et seul le nom de Fincher intrigue. Le choix des acteurs déconcerte aussi. “Gone Girl” va-t-il surprendre son monde comme l’a fait “The Social Network” ? Les lecteurs du livre en ont une petite idée. Réponse en octobre, comme ce fut le cas il y a exactement quatre ans pour “The Social Network”.
Ivan Chaslot
Cinémas lyonnais
Cinémas du Rhône
Festivals lyonnais










